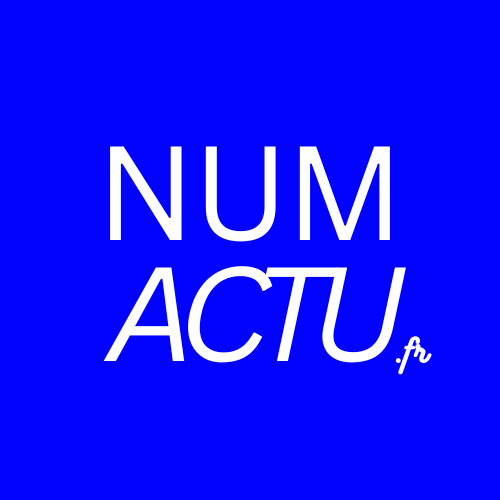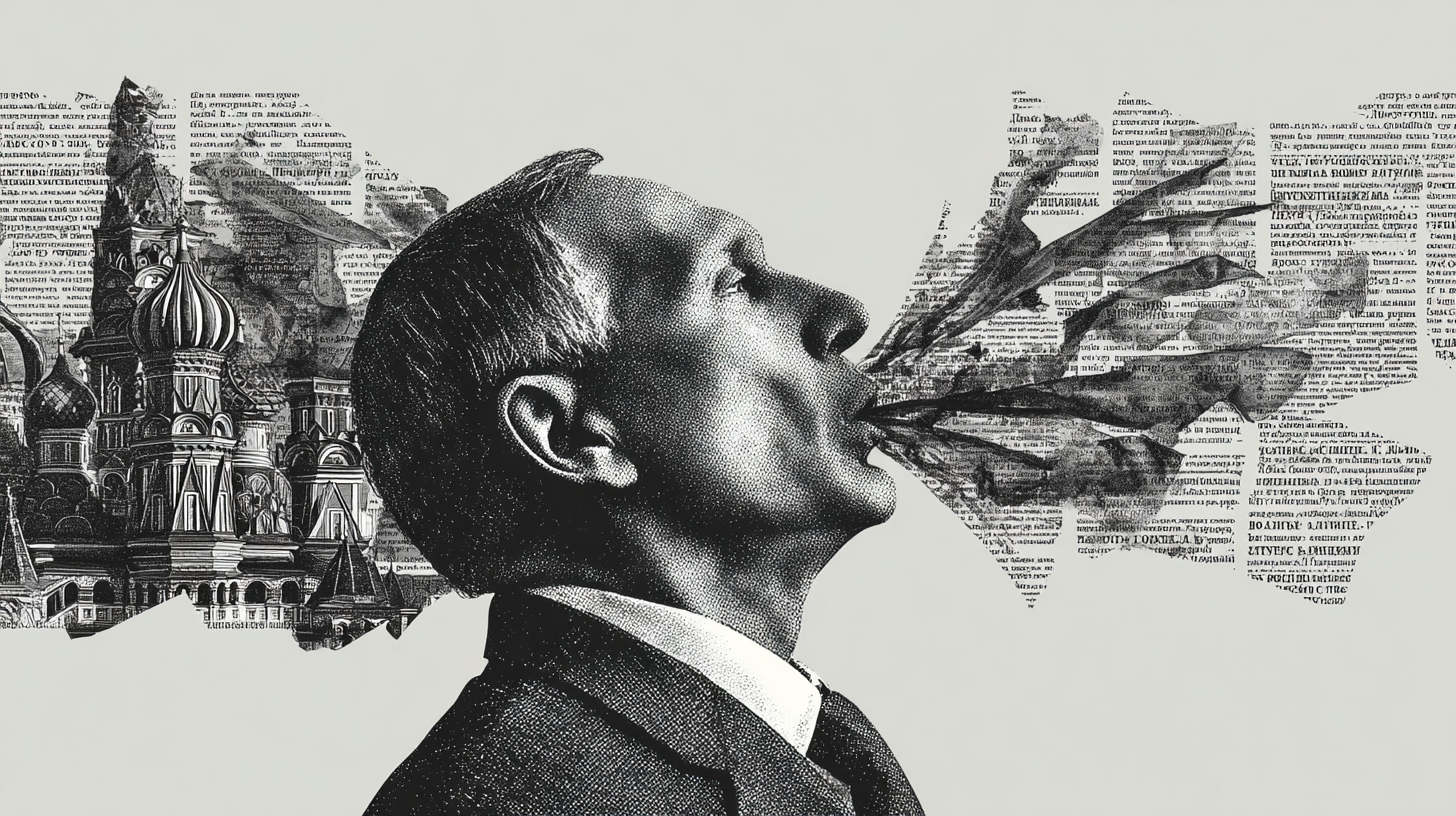Au Népal, une révolte numérique inédite s’est jouée en 2025 : en pleine censure d’Internet par le gouvernement, les jeunes ont investi les VPN, Discord et même le Bluetooth avec Bichat pour organiser une contestation massive. Retour sur un soulèvement générationnel 2.0, qui a conduit à la chute du Premier ministre et à l’émergence d’un nouveau modèle de démocratie décentralisée.
Les manifestations au Népal
L’étincelle est partie de la rue, mais la flamme s’est propagée en ligne. Fin août 2025, des milliers de jeunes Népalais sont descendus dans la rue pour dénoncer la corruption endémique, le népotisme au sommet de l’État, et le manque de réformes. Ce ras-le-bol citoyen, cristallisé sous les hashtags comme #EnoughIsEnoughNepal ou #HamiNepal, a rapidement pris de l’ampleur.
Mais ce qui a rendu cette mobilisation unique, c’est son ancrage numérique : Discord, habituellement réservé aux communautés de gamers, est devenu la plaque tournante de la contestation. Des serveurs entiers ont été créés pour débattre, planifier, organiser les manifestations, et même voter collectivement sur les suites à donner au mouvement.
Face à cette montée en puissance, le gouvernement népalais a tenté une manœuvre radicale : le blocage pur et simple des réseaux sociaux. En l’espace de quelques heures, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X (ex‑Twitter) et Discord ont été bloqués à l’échelle nationale, sur injonction des autorités aux fournisseurs d’accès Internet.
Le message était clair : couper la parole à la jeunesse, interrompre les chaînes de coordination, et reprendre le contrôle narratif. Une méthode classique, déjà vue ailleurs dans le monde : couper Internet pour faire taire la rue. Mais cette fois, ça n’a pas fonctionné.
Le contournement avec les VPN
Car cette génération connectée a plus d’un outil dans sa poche. En quelques heures, les VPN sont devenus l’arme numérique de résistance : en changeant virtuellement leur localisation, des dizaines de milliers de Népalais ont rétabli l’accès aux plateformes censurées.
Mais l’ingéniosité ne s’est pas arrêtée là. Dans les zones de forte coupure ou de répression, les militants ont eu recours à des applications de messagerie offline, comme Bitchat, un outil décentralisé fonctionnant en Bluetooth, sans besoin d’accès à Internet.
La communication a donc survécu. Et mieux : elle s’est intensifiée. Le principal serveur Discord du mouvement (“Hami Nepal”) a continué à grossir, atteignant plus de 100 000 membres. C’est là que le pouvoir a commencé à vaciller.
Acculé, isolé numériquement, et confronté à une pression inédite, le Premier ministre népalais K. P. Sharma Oli a été contraint à la démission début septembre. La rue avait gagné. Et cette fois, ce n’était pas uniquement grâce aux mégaphones ou aux pancartes, mais grâce à des outils numériques de coordination massive, popularisés par les jeunes et amplifiés en ligne.
Ce tournant marque l’un des premiers cas documentés d’un gouvernement renversé sous pression d’une mobilisation numérique native, née, coordonnée, votée et amplifiée intégralement en ligne.
Le choix du nouveau gouvernement via les réseaux
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Dans les jours qui ont suivi la chute du gouvernement, la communauté Discord “Hami Nepal” s’est transformée en véritable agora citoyenne. Des discussions ouvertes ont été lancées pour déterminer qui pourrait porter un projet de transition.
De cette consultation est sorti un nom inattendu : Sushila Karki, ancienne juge en chef de la Cour suprême du Népal, figure respectée pour son intégrité et sa neutralité. Son nom a été voté en tête sur Discord, puis relayé massivement sur les autres plateformes.
Depuis le 12 septembre 2025, Sushila Karki est officiellement Première ministre par intérim du Népal, nommée pour diriger la transition jusqu’aux élections de mars 2026. C’est la première femme à occuper ce poste dans l’histoire du pays — et la première cheffe de gouvernement issue d’un vote spontané lancé… sur Discord.
Quand les gouvernements veulent contrôler les réseaux
Ce cas népalais s’inscrit dans une longue tradition de gouvernements tentant de reprendre le contrôle sur l’espace numérique quand il devient incontrôlable politiquement. Dès qu’un mouvement prend de l’ampleur, la tentation est forte : couper Internet, bloquer les plateformes étrangères, censurer les applications de messagerie.
Mais cette stratégie semble de plus en plus inefficace, surtout auprès d’une jeunesse outillée, technophile, et habituée à contourner les barrières numériques.
Le modèle russe et chinois : contrôle absolu
Certains États ont néanmoins décidé d’aller beaucoup plus loin. La Russie, par exemple, a mis en place sa propre plateforme de réseau social appelée “MAx”, censée remplacer Facebook, Instagram et consorts. L’objectif : offrir une alternative “souveraine”, contrôlable, modérée selon les intérêts du Kremlin.
Même logique en Chine avec WeChat, Weibo ou Douyin, strictement encadrés, modérés en temps réel, et intégrés à l’écosystème de surveillance numérique étatique. Ces États visent un Internet “fermé”, où la contestation est impossible sans être immédiatement identifiée et réprimée.
Le cas du Népal montre que les réseaux sociaux ne sont plus de simples outils de communication, mais de véritables leviers politiques. Quand un État tente de les éteindre, les citoyens s’organisent autrement.
Discord, VPN, Bluetooth : la démocratie passe désormais aussi par la tech. Et dans cette guerre de l’information et de la souveraineté numérique, la génération Z semble avoir une longueur d’avance.