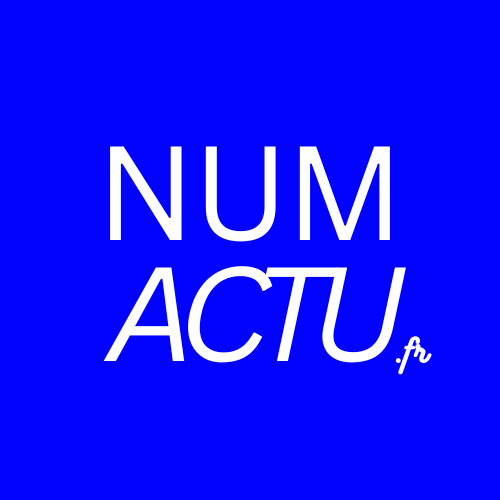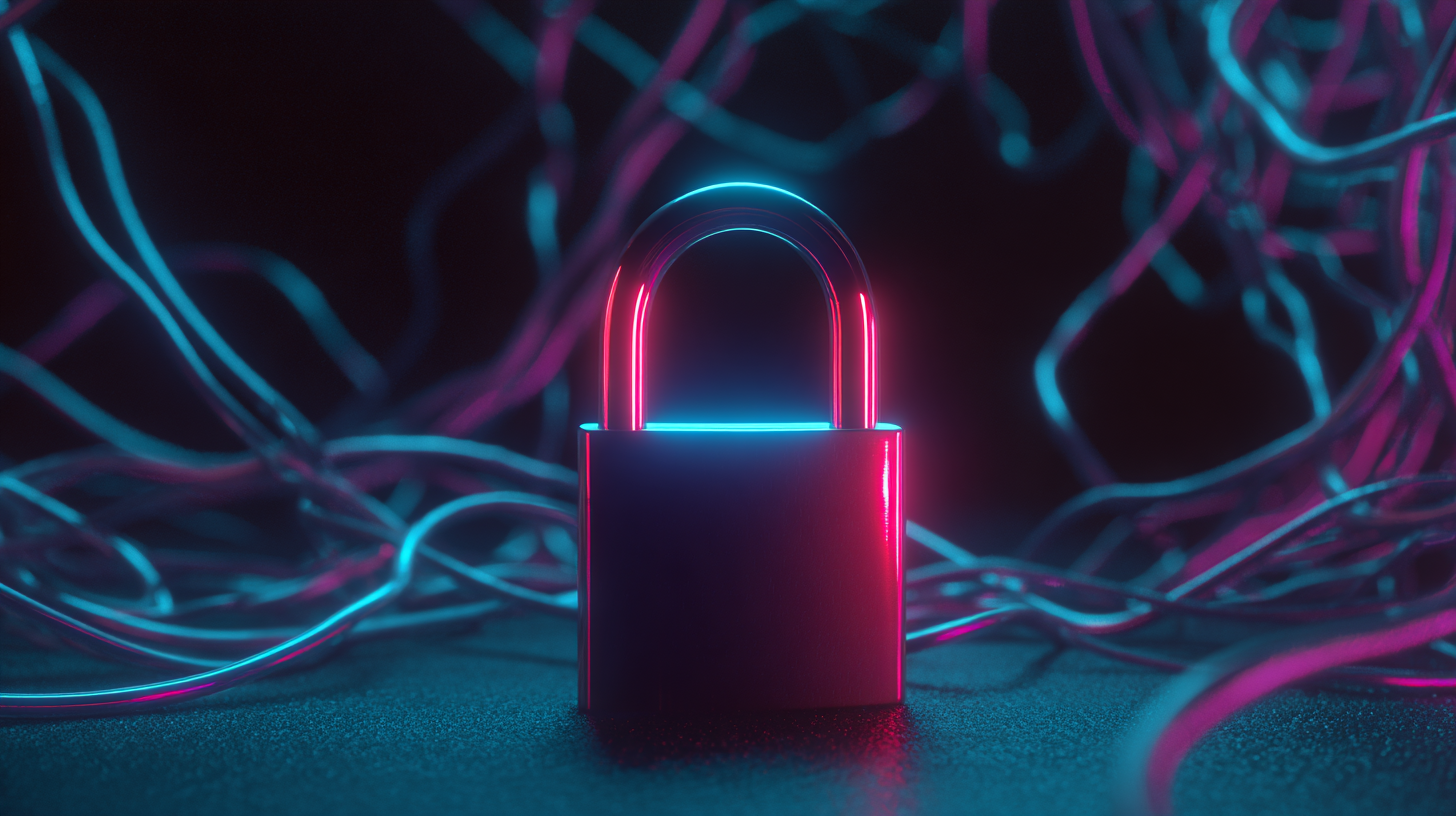L’annonce est passée relativement inaperçue dans les médias généralistes, mais elle soulève des questions fondamentales. D’après le Canard Enchaîné, Matignon a choisi de déléguer la surveillance des réseaux sociaux à Talkwalker, une entreprise basée au Luxembourg mais détenue par le fonds américain Marlin Equity Partners. Ce choix, motivé officiellement par des raisons de performance technologique, marque un tournant dans la stratégie de l’État en matière de veille numérique, à l’heure où la souveraineté informationnelle est au cœur des enjeux géopolitiques contemporains.
L’enjeu ? Analyser les signaux faibles, identifier les tentatives de manipulation, détecter les campagnes de désinformation et cartographier les mouvements de l’opinion publique sur les réseaux sociaux. Un domaine hautement stratégique, autrefois réservé à des services publics ou à des entreprises françaises spécialisées dans l’analyse des données ouvertes. Pourtant, dans le dernier appel d’offres du Service d’information du gouvernement, le choix s’est porté sur un acteur étranger, au détriment d’une entreprise française historiquement impliquée dans ce type de mission.
Talkwalker n’est pas un inconnu. La plateforme est performante, largement utilisée à l’international, notamment dans les milieux du marketing, de la communication de crise et de la veille concurrentielle. Son avantage principal réside dans sa capacité à agréger un grand volume de données, à les interpréter via des modèles d’intelligence artificielle, et à fournir des tableaux de bord synthétiques en temps réel. Pour Matignon, le choix semble répondre à une logique d’efficacité : un outil capable d’alerter rapidement sur des phénomènes émergents, d’aider à la prise de décision politique et d’alimenter les communications officielles avec des données chiffrées.
Mais cette décision soulève des inquiétudes. En confiant cette mission à une entreprise soumise au droit américain, la France expose potentiellement les données récoltées à des obligations extraterritoriales comme le Cloud Act. Cette législation permet aux autorités américaines de demander l’accès à certaines données, même hébergées à l’étranger, dès lors que l’entreprise sollicitée est domiciliée aux États-Unis ou en est la filiale. Autrement dit, même si les serveurs sont situés en Europe, rien ne garantit que les données traitées ne puissent être réclamées par une puissance étrangère.
Pour de nombreux observateurs, il s’agit là d’un renoncement stratégique. Non seulement la décision met en difficulté les solutions françaises en matière de veille numérique, mais elle fragilise aussi la posture politique de la France qui, depuis plusieurs années, plaide pour une souveraineté numérique européenne. En période de montée des tensions géopolitiques, où la guerre informationnelle prend une place centrale, le signal envoyé semble contradictoire.
Du côté des entreprises françaises, l’amertume est palpable. Certaines start-ups tricolores affirment avoir la capacité technique de rivaliser avec les solutions anglo-saxonnes, à condition d’être soutenues par l’État. L’attribution d’un marché aussi sensible à une entreprise étrangère donne le sentiment que l’administration ne fait pas confiance à son propre écosystème, ou qu’elle n’est pas prête à investir dans le long terme pour faire émerger des alternatives solides.
Ce choix pose également une question démocratique. Quand un gouvernement surveille les réseaux sociaux, même à des fins de sécurité ou de prévention des crises, il est essentiel que ce processus reste transparent, encadré, et souverain. Confier cette mission à un prestataire extérieur, c’est aussi s’éloigner du contrôle public et introduire une couche d’opacité supplémentaire dans le traitement des données.
Dans un contexte où les cyberattaques, les campagnes d’influence et les manipulations de l’opinion deviennent monnaie courante, la question de la souveraineté informationnelle devient cruciale. La France, comme d’autres puissances, devra clarifier ses priorités : efficacité immédiate ou maîtrise stratégique à long terme. Si la sécurité des données, la confidentialité des analyses et la confiance dans les outils utilisés ne sont pas garanties, alors le gain technologique immédiat pourrait se transformer en faiblesse structurelle.
Pour éviter cette dérive, les prochains appels d’offres devront intégrer des clauses strictes : traitement des données sur le territoire national, auditabilité des algorithmes, indépendance vis-à-vis de toute juridiction extraterritoriale, et implication renforcée d’acteurs français. Une contractualisation rigoureuse est impérative si l’État veut allier performance et sécurité. Cela suppose aussi de former les décideurs à ces enjeux complexes, pour éviter des choix guidés uniquement par des critères de coût ou de simplicité.
La France dispose d’un tissu numérique dynamique, mais encore trop dépendant des géants du cloud ou des plateformes internationales. Le cas Talkwalker montre à quel point il est urgent de structurer une filière stratégique de la donnée publique et sensible, qui ne soit ni capturée par les marchés, ni soumise à des influences étrangères.
Pour suivre toute l’actualité de numactu.fr, abonnez-vous à la newsletter !