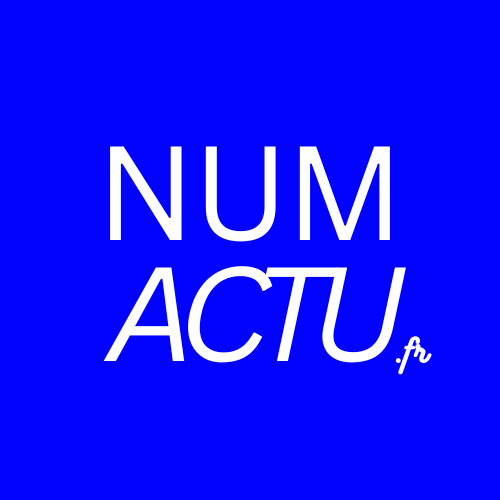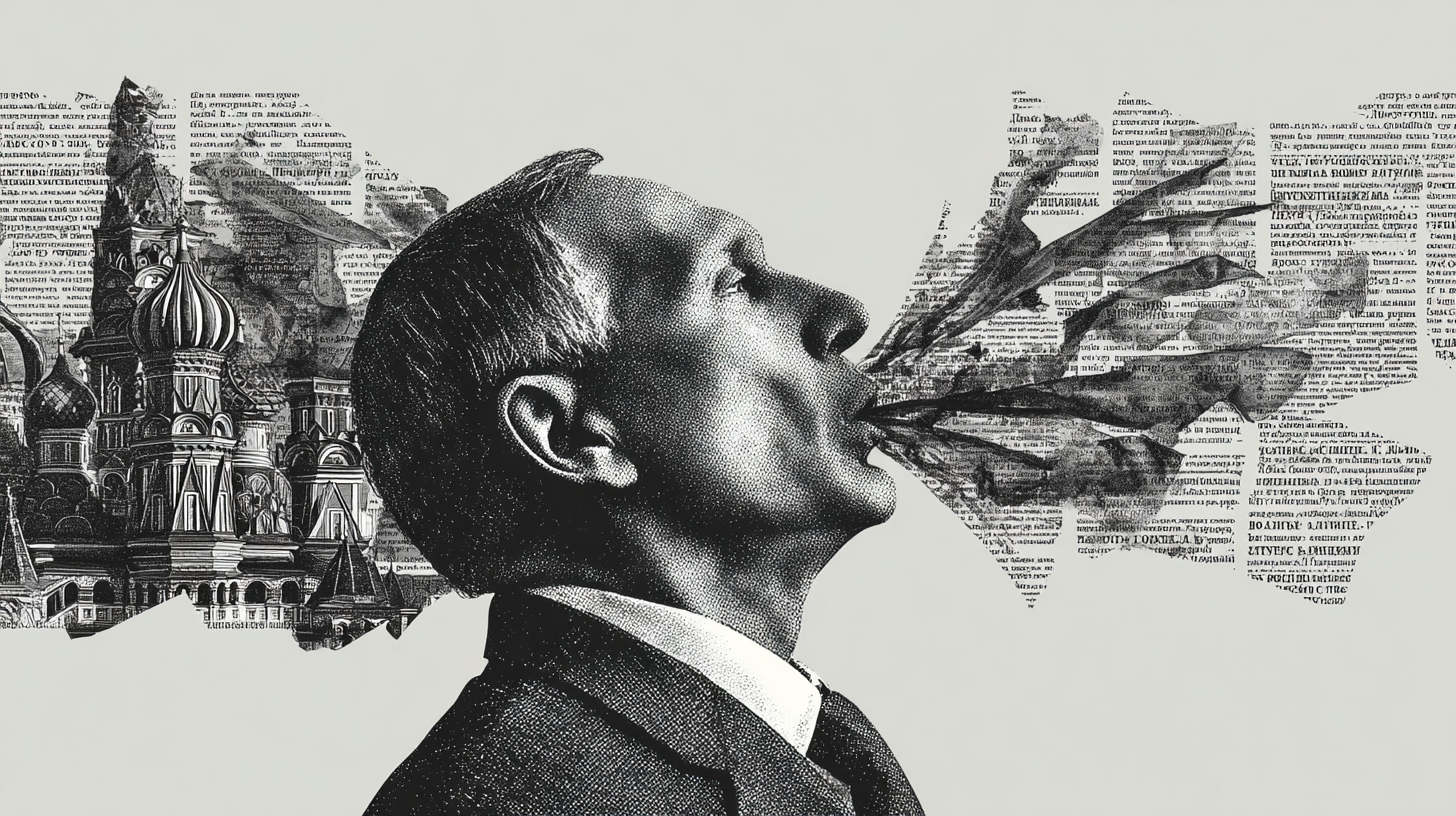Après six mois d’enquête, la députée Laure Miller (Renaissance) remet un rapport très attendu sur les effets de TikTok sur la santé mentale des mineurs. Un signal d’alerte politique fort, avec des propositions choc.
C’est l’un des rapports les plus denses jamais produits sur les effets des réseaux sociaux en France. Remis le 4 septembre 2025 à l’Assemblée nationale, ce rapport est le fruit d’une commission d’enquête parlementaire lancée en avril 2024 à l’initiative du groupe Renaissance, dans un contexte d’inquiétudes croissantes sur l’impact des plateformes numériques sur les jeunes.
Dirigée par Arthur Delaporte (PS) et rapportée par Laure Miller, députée de la Marne, la commission a mené plus de 170 auditions et recueilli les témoignages de 30 000 personnes — dont près de 19 000 lycéens. Son objet : faire la lumière sur les conséquences psychologiques de l’usage de TikTok par les mineurs en France.
Des objectifs clairs : comprendre, documenter, alerter
Derrière cette initiative parlementaire, un triple objectif :
- Évaluer l’impact psychologique de TikTok sur les enfants et adolescents : anxiété, troubles de l’attention, troubles alimentaires, perte d’estime de soi, etc.
- Comprendre le fonctionnement algorithmique et les mécaniques addictives de l’application (scrolling infini, hyper-personnalisation, récompenses sociales, etc.).
- Interroger la responsabilité de la plateforme face à des dérives signalées depuis des années : contenus violents, désinformation médicale, sexualisation précoce, propagande, etc.
Le rapport dresse un constat sans appel : TikTok expose massivement les mineurs à des contenus nocifs, entretient un usage addictif et ne met pas en œuvre les dispositifs de contrôle et de modération à la hauteur de ses responsabilités.
Les mesures proposées : encadrer fermement l’accès et l’usage
Le rapport formule 43 recommandations. Les plus marquantes pourraient transformer radicalement l’usage des réseaux sociaux en France :
- Interdiction de TikTok aux moins de 15 ans, avec obligation de vérification d’âge réelle et infalsifiable.
- Couvre-feu numérique pour les mineurs, interdisant l’accès entre 22h et 8h.
- Création d’un “délit de négligence numérique” pour les parents qui exposent leurs enfants à des contenus inadaptés de manière répétée.
- Suppression totale des téléphones portables dans les lycées, et généralisation du dispositif “portable en pause”.
- Intégration de la prévention numérique dans les carnets de santé et dans les programmes scolaires dès le primaire.
- Renforcement des pouvoirs de l’ARCOM et de la CNIL pour contraindre les plateformes à plus de transparence sur leurs algorithmes et à améliorer la modération.
Ces mesures pourraient, si elles étaient mises en œuvre, faire de la France un des pays les plus restrictifs au monde pour l’accès des mineurs aux plateformes sociales.
Et maintenant ? Vers une loi, une régulation, une bataille politique
Le rapport a été transmis au gouvernement, à la CNIL, à l’ARCOM et aux autres autorités concernées. Mais il ne vaut pas loi : ce sont désormais les ministères et les parlementaires qui doivent transformer ces recommandations en mesures concrètes.
Plusieurs scénarios sont sur la table :
- Dépôt d’une proposition de loi multipartisane dès l’automne 2025.
- Intégration partielle dans un futur projet de loi numérique ou éducatif.
- Mise en demeure de TikTok sur la base du Digital Services Act européen.
- Campagnes de sensibilisation nationale et déploiement de programmes pédagogiques dans les écoles dès 2026.
De son côté, TikTok a réagi en affirmant vouloir “protéger les jeunes” et renforcer ses outils de contrôle parental. Mais la commission estime que l’entreprise a été jusqu’ici largement passive, voire complice, en raison de son modèle économique basé sur l’attention captée.
Le signal est désormais politique : les parlementaires veulent contraindre les géants du numérique à prendre leurs responsabilités, à l’image des règles imposées à l’industrie du tabac ou à celle de l’alimentation. Reste à voir si les outils juridiques suivront.